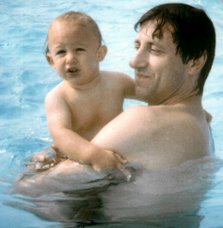Durant le premier millénaire avant JC, les chinois inventent le système binaire (remarqué par Leibniz) qui deviendra la base de l'informatique. Le
Yi Jing est un livre des mutations qui se décompose en 2, 4, 8 éléments de base, 16, 32, 64 variations. Cette bipolarité est l'essence de l'univers, dont nous en avons une représentation avec le ying et le yang complémentaires, concurrents, antagonistes.
Le
Confucianisme se dit rujia (Ecole des lettrés). Seuls des fonctionnaires lettrés qui sont les garants de l'ordre se doivent d'appliquer cette philosophie conservatrice. A l'opposé, le taoïsme et le bouddhisme seront plus vivants et spontanés. Kongfuzi (en chinois) né en 551 avant J-C dans la principauté de Lu, passe de nombreuses années au service d'un ministre. Il finit les trois dernières années de sa vie à écrire et à enseigner sa philosophie des relations sociales justes et harmonieuses avant de mourir en 479 avant J-C.
Lors de la dynastie Qin (-221 à -206), Li Si fait arrêter en masse les confucéens et quatre cent soixante d'entre eux sont enterrés vifs. Les tyrans n'ont guère d'imagination et tuent qui pense. La dynastie est trop courte pour imposer sa dictature et se trouve renversée pour fonder la dynastie Han. Le confucianisme devient alors la philosophie officielle de l'Etat. La doctrine allait en profiter autant qu'en pâtir. Certes on l'adapte aux conditions sociales et politiques nouvelles, mais on choisit de préférence les fonctionnaires parmi les gens formés par le confucianisme.
il s'agit toujours de se rapprocher autant que possible d'un idéal, d'un dieu, d'un paradis, exaltés dans le plus lointain passé. De sorte que cette pensée qui à l'origine devait développer en chacun de nous sa « forme maîtresse » allait devenir, en conquérant la Chine, un dogmatisme, une sorte de religion d'État fondée sur le culte du héros et des ancêtres.
Le
Taoïsme est né sous cette dynastie Han (-206 à 220). Il puise ses doctrines dans des traditions anciennes comme Huang-Lao, une tradition très connue après Huang Di (Empereur Jaune) et Lao-Tzu, maître de l'époque des Printemps et Automnes, fonde la première école puritaine du taoïsme. L'idée de la "Voie" (Dao) dans son "Livre de la voie et de la Vertu" (Dao De Jing) constitue le fondement du système taoïste.
Philosophie à l'origine, nostalgique des origines, le taoïsme situe généralement l'âge d’or avant l’histoire et les empereurs, supposant une douce communauté paysanne sans ordre politique. La révolte des Turbans Jaunes a fait vaciller la dynastie préfigurant une période de troubles et de grandes migrations barbares. Vers l'an 240, le taoïsme diverge en dào jià (philosophie) et dào jiào (religion). A la chute de la dynastie Han, commence la période des trois royaumes de Shu (蜀),Wei (魏) et Wu (吳) qui s'affrontent pour la domination de la Chine, jusqu'à l'avènement de la dynastie Jin en 265. Pourtant de ces guerres, une église des 5 boisseaux est constituée à base de taoïsme et se poursuit jusqu'à nos jours sous le terme de Maîtres célestes. Mobilisation des foules, retour d'un âge d'or de morale et de religion, effrite l'empire avant l'arrivée du bouddhisme.
Le Bouddhisme commence à se répandre hors de l'Inde par une époque de lente assimilation et d'adaptation durant les 4 premiers siècles de notre ère. L'influence arrive dans les milieux aristocratiques des villes avant de pénétrer dans les campagnes. Méditation, concentration mentale, certaines de ses conceptions philosophiques, le bouddhisme présente des analogies avec le taoïsme.
La presque totalité des traductions de textes bouddhiques en chinois date de la période comprise entre le 2e et le 9e siècle. Les Chinois n'ont retenu qu'un petit nombre de textes sacrés du bouddhisme, mais c'est par l'importance attachée à certains textes célèbres que se distinguent les grandes sectes bouddhiques chinoises. Il faudra attendre le 5e siècle jusqu'au 9e pour atteindre une grande ferveur, à tel point que le bouddhisme fait la conquête de la Corée et du Japon.
Mais une réaction nationale et antibouddhique s'amorce avec Han Yu (768-824). S'ensuit une proscription des religions étrangères entre 842 et 845 qui porte un coup sévère à l'essor du bouddhisme en Chine, avec destruction des œuvres d'Art.
Il faudra la fin de l'époque mongole qui inspirera des mouvements d'insurrection au 14e siècle jusqu'au début du 19e siècle pour voir une expansion dans toute la zone des steppes du bouddhisme tibétain connu sous le nom de lamaïsme.
Le Consensus sinicus, dès le 11e siècle, tient l'univers pour un immense organisme. Il serait insensé de chercher une origine, une cause, une forme, des limites, un sens et une fin. Totale absence de religiosité, seulement une prudence et une modestie devant le spectacle de la nature. Une telle manière de voir est commune au taoïsme, au confucianisme et même à la forme du bouddhisme mahayaniste la mieux assimilée à la Chine : le Chan. L'échange est permanent entre le ciel et la terre, à laquelle appartiennent choses animées et inanimées nourrit de l'énergie "qi" partout régnante. Cette énergie est le fondement de la philosophie de Schopenhauer, pour qui "qi" (souriez et achetez un kiki) est appelé "volonté" véritable substrat qui régit toute chose par le philosophe allemand. Ses détracteurs ne se privaient pas de le traiter de "bouddhiste en Europe". Aucune frontières entre l'homme et l'univers, dans lequel il trempe et subit par le même ordonnancement qui convient à l'extérieur. "Chaque être est autre chose, et même autres choses. Autre encore il deviendra".
"Celui qui parvient à briser la muraille de l'entendement ou, mieux, à la dissoudre en dissolvant l'entendement lui-même pour se retrouver - dès lors sans objectivité - réunifié en tai yi, par une sorte de coalescence que le langage est impuissant à énoncer, celui-là est le zhen ren, « l'homme véritable », « l'homme qui chevauche le vent ». In vivo, il a connu le dao. L'homme ordinaire, enchaîné par les désirs et les passions, l'homme malheureux, l'homme malade, en sont les contraires." Le changement est donc le procès foncier de l'univers et de ce qui s'y déroule : c'est la loi du yin et du yang.
Le Yin et Yang sont des indices dont se trouvent affectées les variations du qi. (volonté ou force qui régit l'univers). Il y a compénétration. Ils sont inséparables et impensables séparément. A l'image du jour et de la nuit, il ne sont pas opposés. Ni Yin ni Yang ne sauraient être absolus, c'est le dao. "La Chine applique à tout ces indices qui lui permettent de signifier des évolutions et des involutions relatives les unes aux autres, des cycles et des périodes, et de tenir tout état de fait pour un équilibre instable, rompu et outrepassé sans heurt sitôt atteint. S'il y a là une dialectique, c'est une dialectique qui va au-delà d'une dualité surmontée et perpétuée à l'infini ; c'est une dialectique réputée naturelle où l'homme, qui en est baigné, n'introduit rien, ni la négation, ni la matière, ni l'esprit."
Toutefois, la conception indienne d'une temporalité homogène est négligée par le chan (bouddhisme en Chine) autant que par le confucianisme et le taoïsme pour lesquels il n'y a de temps que le temps de l'événement.
Pas l'ombre d'une métaphysique religieuse, pas d'âme individuelle, ni Dieu, ni création, ni au-delà, dans la sagesse chinoise. Développement, différenciation biologique, continuité psychique ne sont censées exister que postérieurement à la naissance par l'idéation, l'entendement et à la volonté.
Rites confucéens et cérémonies taoïstes populaires n'ont pas la nécessité d'une transcendance. Mais une proximité symbiotique de l'homme à la terre et au ciel, qui l'imprègnent et auxquels il se soumet. "Il est peu de chose par lui-même ; si peu que rien, pénétré, imbibé par l'univers dont il figure une parcelle passagère, un concours circonstanciel, un incident parmi une infinité d'autres, dont il témoigne à défaut de meilleur témoin. L'homme chinois est poreux. On ne peut perdre de vue cette approche anthropologique si l'on s'intéresse à la Chine, à celle du fondateur mythique, Huangdi, le grand empereur jaune, aussi bien qu'à celle de Mao".
Le Maoïsme se veut un communisme démocratique en harmonie avec le Tiers Monde. Sa terreur n'en est pas moins policière ni moins bureaucratique que celle de Staline.
Né le 26 décembre 1893 à Shaoshan, village de la province centrale du Hunan, Mao voit le jour en même temps que le nationalisme réformiste et révolutionnaire qui abat la dynastie mandchoue des Qing (1644-1912). Avec l'enthousiasme de ses vingt ans, il prend les armes contre ces conquérants. Il se dérobe au projet paternel, à la discipline de l'école, rétif aux institutions et au pouvoir des autres.
En 1919, il obtient un diplôme d'instituteur. Le capitalisme s'affirme, surtout à Shanghai. Les intellectuels dénoncent le carcan des traditions : contre l'emprise du confucianisme, une révolution dans la culture doit ouvrir les portes de l'avenir. Or la même année, l'exemple russe se durcit sous leurs yeux, passant de la démocratie des soviets à la dictature bolchévique.
En 1927, Mao s'éloigne de la pure orthodoxie prolétarienne pour prendre acte d'une dimension plus fondamentale du léninisme : la violence féconde des luttes de classe. Le Maoïsme prend forme lorsqu'il envisage un soulèvement rural à l'échelle de l'ensemble chinois.
En 1935, la longue marche est une étape dans l'ascension de Mao. Il faudra l'invasion japonaise en été 1937 pour redonner à son entreprise l'envergure politique. La perte de la tutelle russe sur le PCC renforce l'innovation du communisme rural.
En 1945, Mao devient président du comité central de PCC. Il développe son pouvoir dans un contexte de sous-développement : "sous son vernis de rusticité, le produit fini apparaît comme la version laborieuse et fignolée des techniques bolcheviques. L'action globale est révolutionnaire ; la révolution, dans son détail, l'est fort peu." De 1946 à 1950, le mouvement lui donnera la maîtrise exclusive des campagnes, construction d'un politique d'une autre espèce.
En 1956, il défend Staline contre Khrouchtchev, tandis que des barons du PCC critiquent le culte de la personnalité. Dans une révolution « ininterrompue », « le politique dirige tout ».
En 1958, le chaos, suit entre 1959 et 1961 la famine (20 ou 30 millions de morts). La militarisation du système politique c'est le pouvoir « au bout du fusil ».
"Les techniques du pouvoir qu'il a élaborées ont précisément fait jouer une opposition entre institutions et mobilisation des masses. Toutefois, puisque les mobilisés sont des dominés, à quoi bon s'ingénier à les répartir entre des classes et à proclamer des luttes entre celles-ci, puisqu'elles ne sont pas autonomes face au pouvoir ? Le socialisme abrite-t-il des contradictions ?"
La Révolution culturelle commence en 1966. Mao peut compter sur la fanatisation des jeunes et sur les laissés-pour-compte d'une société. Une enseignante de philosophie, Nie Yuanzi raconte : "La mise à feu a eu lieu, et toute la jeunesse est lancée dans le mouvement. Les écoles ferment - pour plusieurs années - en juillet, et les étudiants et élèves sont organisés en gardes rouges : ils se diviseront immédiatement en factions concurrentes, fils de cadres et de militaires s'opposant aux jeunes des anciennes classes bourgeoises, du prolétariat et aux intellectuels. En août 1966, le comité central est réuni : mais de nombreux délégués sont empêchés d'y participer, et des soldats les remplacent dans la salle. Au nom de l'« échange d'expériences révolutionnaires », Mao convoque la jeunesse à Pékin. Par millions, bloquant trains, gares et lieux publics, ils affluent vers la place Tian'anmen, où des meetings monstres se déroulent devant l'ensemble des dirigeants, promis pour une part à l'épuration."
Naît l'éphémère presse des gardes rouges, avec son culte maoïste délirant. La chasse aux « révisionnistes » commence, qui sera fatale à de nombreux cadres, mais surtout à la quasi-totalité des intellectuels, artistes et créateurs chinois : battus, déportés ou massacrés, au nom de la lutte contre les « herbes vénéneuses ». Avant la fin de l'année, Peng Dehuai, Liu Shaoqi, Peng Zhen et Deng Xiaoping sont arrêtés, avec des milliers de dirigeants civils et militaires. Si certains sont mis à mort, d'autres auront la vie sauve, ce qui constitue encore une divergence du maoïsme par rapport au stalinisme.
En avril 1969, le IXe congrès du parti, dans une liturgie maoïste, Lin Biao élève Mao au rang de « génie ».
En août 1970, Chen Boda disparaît. La lutte au sommet s'exacerbe, avec Zhou Enlai, Jiang Qing et Lin Biao comme principaux protagonistes.
Le 13 septembre 1971, le monde extérieur apprend progressivement la mort de Lin Biao, deux ans après sa désignation comme successeur de Mao.
En avril 1973, Deng Xiaoping, qui avait été après Liu Shaoqi la cible numéro deux de la révolution culturelle, est réhabilité comme vice-Premier ministre. Ce retour en grâce suit le rapprochement avec les États-Unis de 1972.
"Au Xe congrès du parti, les radicaux lancent un nouveau mouvement : la campagne contre Lin Biao est amalgamée à une dénonciation de Confucius. L'objectif est de dénoncer le conservatisme des « lettrés », c'est-à-dire de Zhou Enlai, et de rendre hommage à Mao Zedong sous les traits de Qin Shi Huangdi, fondateur dynastique brutal qui élimina ces lettrés néfastes du pouvoir. L'offensive culmine au printemps de 1974. La propagande, où les activistes de la révolution culturelle demeurent les plus nombreux, s'en prend notamment au film Chung Kuo du cinéaste italien Antonioni, qui avait été invité en Chine par Zhou Enlai, ainsi qu'à la musique classique, au « révisionnisme » économique, à l'inégalité devant l'éducation et au « droit bourgeois »."
En 1976, Hua Guofeng devient Premier ministre. Mais, à nouveau, les troubles prennent de l'ampleur dans le pays. La réalité du pouvoir devient régionale, et Deng Xiaoping attend son heure. Le tremblement de terre de Tangshan en juillet (250 000 morts) signale la fin d'un règne. Le 9 septembre, Mao Zedong expire. Un deuil d'un mois est décrété, pendant lequel chaque faction se mobilise. Le 7 octobre, Hua Guofeng, renversant ses alliances, fait arrêter la « bande des Quatre » : la veuve de Mao, Jiang Qing, est accusée d'avoir fomenté un coup d'État. Cette date, qui sera considérée officiellement comme une « seconde libération », marque aussi la fin de l'ère maoïste. Une foule en liesse envahit les rues, et participe bientôt à une grande campagne de masse, contre les héritiers de Mao cette fois-ci.